Science sans conscience… Suite
Sciences de la matière contre Sciences de la vie
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. », ne l’oublions jamais,
(François Rabelais) (Vers 1494–1553)
« (…) Where is the wisdom lost in knowledge ? Where is the knowledge lost in information ? »
(Thomas Stearns Eliot) (1888–1965)
Deux conceptions qu'à la base tout sépare
Le rationalisme est une croyance comme une autre
… en plus rationaliste évidemment
… et peut-être aussi un peu plus intolérante et sectaire que la moyenne.
Les faits se montrent plus scientifiques que les préjugés.
Étant clairement précisé que la biologie classique – qui se revendique pourtant comme La Science de la vie – s’apparente en réalité bien plus à la science de la seule matière, à la science de l’inerte et de l’inanimé.
Il y a une faille, un abîme – ontologique – entre la matière inerte, inanimée, et la matière organisée, animée, dirigée, qu’est le vivant.
Et puisque l’impalpable et l’essence même de la Vie lui échappent complètement, il n’y a là rien de surprenant qu’elle ne connaisse pas davantage ce qu’est réellement la « conscience » ou la « mort »…
« Le mystère de la vie n’est pas une question à résoudre mais une réalité à vivre. »
(Frank Herbert) (1920–1986)
Einfache « Weltanschauungs Frage », comme diraient les philosophes
Modernité contre tradition – Réductionnisme contre holisme – Profane contre Sacré
Irréconciliables ?
Éternelle question de croyances et de conception du monde
Iconoclasme contre iconolâtrie
Les racines de cette opposition fondamentale remontent à la scission progressive, irrémédiable – et jusqu’alors définitive – entre la science « antique » et l’avènement des sciences « modernes » – ou ses prémices – que certains auteurs situent quelque part au cours du Moyen-Âge.
Une science divise. L’autre unifie. L’une oppose, l’autre compose.
(…)
« L’incertitude constituerait-elle le premier temps de la démarche éthique ? » avance prudemment Boris Cyrulnik.
Question de niveaux de Réalité (ou de niveaux de conscience)
Du conditionnement… et des faiseurs de Réalité
Qu’est-ce au juste que la Réalité ? Qu’est-ce que la Vérité ?
Que sais-ton vraiment de La Réalité ? Où se situe la Vérité objective, intrinsèque ? Dans quel référentiel est-ce que je me situe ?
Ne confondons-nous pas trop souvent réalité et pseudo-réalité ? Réalité et projection (de l’esprit humain) ? Réalité et l’une ou l’autre de ses ombres ? Et puis, quel contrôle effectif avons-nous sur la pseudo-réalité qui nous entoure ?
Chercheur intègre cherche désespérément vérité objective
« Étant donné la faiblesse de nos sens, nous ne sommes pas à même de disposer d’un critère du vrai. »
(Anaxagore) (Vers 500–428 av. J.-C.)
Et cela risque de rester avéré quelque temps encore.
Que connaissons-nous vraiment de la Vie ?!
Quel type de grenouille êtes-vous ?
L’être humain est-il (seulement) un simple corps (physique) cornaqué par une volonté (totalement endogène) ?
Étudier la vie in vitro (en éprouvette) et étudier la vie in vivo (dans son milieu) sont deux approches diamétralement opposées. La vie, en effet, ne se laisse pas enfermer dans des boîtes, ne se laisse pas réduire au seul visible, ne se laisse pas assimiler à la seule matérialité, ne se laisse pas soumettre aux dogmes – fussent-ils 200 % scientifiques.
Vous reprendrez bien un peu de soma n’est-ce pas ? (N.F.)
« Nous nous sommes accoutumés aux hommes qui se moquent de ce qu’ils ne comprennent pas. »
(Johann Wolfgang von Goethe) (1749–1832)
Résumé très brièvement…
1/ Réductionnisme délibérément choisi – et revendiqué -… pour les uns
Matérialisme, biologisme, chosisme… même combat !
La science moderne, par définition, se centre et se concentre exclusivement sur la matière, le tangible, le quantifiable, et réfute en conséquence, dans son essence même, toute possible métaphysique.
Seul le corps biologique, matériel, physique est étudié. Les corps subtils sont totalement ignorés / réfutés. Le minéral, le végétal, l’animal, l’humain, la nature, le vivant, l’univers, etc. sont considérés comme des machines que l’on réduit à leurs fonctions exprimées, observables, que l’on découpe en systèmes et sous-systèmes dont on étudie chaque rouage. Les sciences de la matière ne voient, n’étudient et ne dissèquent que cette dernière c’est-à-dire ce que l’on peut toucher, mesurer, quantifier, manipuler, découper, triturer, photographier, imager, etc. Elles sont analytiques, « quantitativistes », déterministes et réductionnistes. Le non quantifiable est formellement exclu. Il n’a aucun droit de cité.
Postulat (= croyance) dont d’ailleurs elle s’enorgueillit et se glorifie larga manu tout en reprochant aux approches traditionnelles, holistiques – qui elles à l’inverse ont une vision du monde, une conception de la réalité beaucoup plus large et ouverte – de ne pas la suivre dans son aveuglement réductionniste. La condamnation de ces dernières par la première nommée parachève le procès avec l’hostilité et la virulence que l’on sait.
Au sein de la science contemporaine hyper techniciste, tout comme du reste dans notre monde en général, depuis fort longtemps, le microscope a complètement supplanté le macroscope. Plus la science se focalise sur des détails, plus elle utilise des instruments d’analyse sophistiqués, et plus grand, semble-t-il, est le risque que simultanément elle se coupe de la chose observée, plus la réalité première menace de se dérober durablement à elle. Le mystère de la vie se révèlera-t-il sous les dissections, au bout du scalpel ? Se trouvera-t-il dans le champ du microscope ? J’en doute fortement.
Ainsi, la « réalité », appréhendée au travers des verres spectaculairement grossissants de l’appareillage scientifique classique, est-elle devenue si fragmentée, si tronçonné, si saucissonnée, si éclatée. Si focalisée sur les détails, obnubilée par les apparences, le visible, le tangible, la matière physique – par laquelle seule, la science moderne jure – que cette dernière en a complètement perdu de vue la globalité, qu’elle en a gravement oublié le cadre et la totalité.
Le spécialiste, l’expert, n’est-il pas celui qui connaît tout… sur rien, ou du moins sur si peu (au sens où son domaine de connaissance – si étendu soit-il – demeure en fin de compte tellement infime, tellement insignifiant en regard du restant de l’univers).
Cette myopie calamiteuse, cette totale prépondérance du palpable sur l’intangible, cette absolue primauté du visible sur l’invisible, cette superbe – et orgueilleuse – ignorance de l’énergétique et de la métaphysique a grandement contribué à conduire notre monde dans la douloureuse impasse que l’on connaît.
Vous reprendrez bien un peu de soma n’est-ce pas ? (N.F.)
« La vie est, en elle-même, un effort exécuté par un ensemble complexe ordonné, architecturé, et un effort orienté : être vivant et le demeurer. »
(Pierre-Paul Grassé) (1895–1985)
2/ Ouverture maximale à l’univers et à l’invisible fièrement affichée… pour les autres
Holisme, métaphysique, supraphysique
Les sciences de la vie, par contre, voient le monde davantage dans sa globalité et sa qualité.
Elles ont de la réalité, de la Vie, une vision plus vaste, plus globale. Elles sont synthétiques, « qualitativistes » et intégratives.
La vie y est considérée comme un tout indivisible, indissociable. Pour ses tenants, l’être vivant est composé de bien d’autres couches, niveaux ou enveloppes « invisibles » à nos sens que le corps physique tel que nous le connaissons, ce dernier n’apparaissant qu’en bout de chaîne, qu’en dernière instance, n’étant que la partie visible, palpable, perceptible par nos sens communs, un peu à l’instar d’un iceberg dont seule une petite fraction émergée – visible – dépasse la ligne des eaux. Le Vivant ne peut être perçu que par le Vivant.
(…)
En d’autres termes, c’est la vision de l’aigle par opposition à la vision de la fourmi, pour reprendre la métaphore chère à Carl Gustav Jung.
Nous croyons connaître le monde, mais en réalité, en savons si peu !
L’ignorance, l’exclusion ou le rejet de ces niveaux différents de réalité sont à l’origine de tant d’incompréhensions.
95% du contenu de l’Univers restent inconnus.
« La science nous dit ce que nous pouvons savoir. Mais ce que nous pouvons savoir est peu.
Et si nous oublions ce que nous ne pouvons pas savoir, nous devenons insensibles à bien des choses de très haute importance. »
(Bertrand Russell) (1872–1970)
Funeste dualisme Esprit / Matière
Les constats sont plus rationnels que les conjectures
Funeste dualisme Esprit / Matière
Médecine de la maladie contre médecine de la santé
Médecine de la matière contre médecine holistique
Techno-médecine contre médecine humaniste
« Esprit et matière se font exister, se constituent, se soutiennent l’un et l’autre contre tout dualisme, l’homme est constitué d’un seul Être où la Matière et l’Esprit sont des principes consubstantiels d’une totalité déterminée sans solution de continuité, par leur mutuelle inhérence » écrivait St Thomas d’Aquin (1224/25–1274).
Terra incognita
Un autre continent – mal connu – de la médecine
Pour un certain nombre de scientifiques modernes et de praticiens médicaux conventionnels, les médecines naturelles (ou « non conventionnelles ») apparaissent encore comme une parfaite – et parfois absurde – Terra incognita. Les raisons en sont multiples.
Le législateur et les pouvoirs publics plébiscitent les premiers et ignorent – voire rejettent – les secondes. Leur univers respectifs sont strictement et hermétiquement cloisonnés. Les formations des uns et des autres se croisent si rarement.
Les premiers nommés approchent la vie de façon très analytique, mécaniste, réductionniste, déterministe, et osons le dire, profane, alors que les seconds l’étudient en privilégiant largement une vision organique, englobante, holistique, métaphysique, et pour ainsi dire, en ultime considération, sacrée. Les premiers se concentrent sur le symptôme, les seconds ont davantage le souci de l’être dans sa globalité. Les premiers travaillent avant tout sur la matière et se focalisent sur la maladie, tandis que les seconds s’appliquent surtout à restaurer les conditions de la santé et, par extension, de la vie.
Même leurs définitions respectives de la santé et de la maladie font le grand écart ! Là où les premiers voient – ou jusque récemment voyaient – une absence de maladie, les seconds voient un état d’équilibre dynamique, une libre circulation de la vie sur les différents plans de l’être.
Conséquence logique : là où les uns constatent une malchance, une fatalité, un déterminisme génétique, un accident – soit globalement une cause exogène –, les autres y discernent prioritairement des causes endogènes (physiques ou psychiques) et perçoivent là un message, une invitation au changement, un évènement porteur d’évolution. Là où les premiers voient un mal, une maladie, une pathologie, les seconds voient une tentative salutaire d’ajustement et d’équilibrage de l’organisme. Là où les uns appréhendent la maladie comme l’ennemi à abattre, les seconds considèrent que la mal-a-die cherche tout naturellement à guérir son porteur. Là où les premiers tendent à rendre leurs patients dépendants (d’une substance, d’un traitement, etc…), les seconds s’efforcent de rendre leurs consultants le plus autonomes possible. Là où les premiers incriminent et cherchent à éradiquer un agent causal pathogène, les seconds s’emploient surtout à renforcer et à corriger le terrain biologique pour favoriser le retour à l’équilibre. Car aux yeux de ces derniers, pour guérir – tout au moins durablement – il ne suffit pas de combattre, juguler et réduire au silence les symptômes, il faut surtout rechercher et trouver la cause première du trouble et viser à rétablir l’équilibre rompu. Tout en s’assurant d’une nutrition optimale et d’un assainissement (drainage) efficace. Tout en stimulant l’énergie vitale. Tout en favorisant, accompagnant le courant de vie puissamment régénérateur et curatif.
Etc. etc…
Et bien entendu, il est officiellement dit que seuls les premiers savent et, par conséquent, sont en mesure (= « ont le droit ») de soigner…
« Lorsqu’il s’agit d’un art sauveur de la vie, négliger d’apprendre est un crime ! »
(Samuel Hahnemann) (1755–1843)
Ce n’est pas qu’une médecine soit bonne et l’autre mauvaise. L’une utile et l’autre inutile. Que l’une soit estimable et l’autre méprisable. Non ! Les deux sont nécessaires. Les deux ont leurs indications. Utilisées à bon escient, les deux sont précieuses. Les deux sont capables de prodiges. Judicieusement combinées, les deux peuvent faire mieux que chacune toute seule. Et il arrive même que leur association, leur synergie fasse parfois… un miracle… et demi !
Certainement est-ce là aussi le conditionnement d’un enseignement ou bien la résultante d’une philosophie de vie. D’où tous ces innombrables quiproquos tout aussi regrettables que préjudiciables tant pour la santé individuelle que collective.
La meilleure des médecines, c’est l’alliance des médecines. C’est la médecine institutionnelle (classique) et les médecines naturelles œuvrant ensemble étroitement à la santé du monde et de ses habitants.
(…)
« L’essentiel est invisible pour les yeux. »
(Antoine de Saint-Exupéry) (1900–1944)
La vie, c’est l’énergie, l’information, la lumière
La vie n’émane pas de la matière, elle s’incarne, s’exprime à travers elle
À l’inverse, les médecines naturelles – pour lesquelles le macroscope continue d’être l’instrument d’analyse largement privilégié – sont, quant à elles, toutes sans exception, irréversiblement focalisées, centrées, sur la vie. Alors qu’on les qualifie volontiers d’énergétiques(*1), la simple évocation de ce mot apparaissait – et apparaît de nos jours parfois encore – aux tenants de la science qui se revendique pourtant comme « exacte » (toutes les autres étant alors pour eux, par définition inexactes et fausses) comme le sommet de l’incompétence, comme l’hérésie par excellence, comme l’incarnation consommée du parfait charlatanisme… Mais notre monde tout entier ne crève-il justement pas de la problématique énergétique(*2) !… Votre radio, votre téléphone, votre voiture, votre réfrigérateur, votre ordinateur, etc. fonctionneraient-ils sans énergie ? Et vous aussi ?…
Pas d’énergie, pas de vie ! Aucune activité, aucune fonction ne peut se produire sans énergie.
Pour vous faire une bonne idée de la chose, observez par ex. ce qui se passe lors d’une panne d’électricité (tout le monde en a connu au moins une)… Je vous laisse libre de la conclusion.
Il y a des choses, sur Terre – et dans l’univers –, qui nous resteront longtemps encore incompréhensibles. Reconnaissons-le avec la nécessaire humilité.
(*1) : Étant bien précisé que le concept d’énergie dépasse très largement les notions d’ATP et d’influx nerveux.
(*2) : Alors que, paradoxalement, l’univers regorge, déborde d’énergie, baigne dans une énergie absolument phénoménale ! Nous sommes comme de misérables poissons assoiffés d’eau tout en étant plongés dans un immense océan liquide !
LA RÉALITÉ SURPASSE LA THÉORIE… ET AUSSI LA PRATIQUE.
« Le vivant n’est compréhensible que dans sa globalité. »
(Hans Driesch) (École des Vitalistes allemands)
Que de « malades imaginaires » – au propre comme au figuré – qui courent les rues !
En ce début de 21e siècle, l’étonnante puissance de l’esprit humain semble encore échapper à certains esprits supérieurs imbus de rationalité.
Il en va ainsi de la psychosomatique(*) (possible origine psycho-émotionnelle de certains troubles physiques), et dans une moindre mesure de la somato-psychique (possible origine physique de certains troubles psychiques)… toutes deux jusqu’il y a relativement peu obstinément ignorées, superbement réfutées, et royalement exclues du champ de la physiologie, des troubles et de la pathogénèse par la science classique et la médecine institutionnelle.
Souffrances d’autant plus volontiers mises en doute – voire réfutées – qu’aucune anomalie dans les investigations communément menées ne vient étayée les dires du consultant. Ne reste alors classiquement à ce dernier que deux issues principales : abandonner la partie ou se faire psychiatriser… À moins de trouver in extremis, au terme d’un vrai parcours du combattant, un praticien alternatif – par d’aucuns si hâtivement qualifié de « charlatan » – capable de vues suffisamment « stupides », « farfelues » et « anti-scientifiques » pour comprendre et venir en aide à ces innombrables incompris – si facilement qualifiés d’« emmerdeurs / emmerdeuses », de « casse-couilles » par les tenants de la médecine institutionnelle.
(*) : Ou, plus justement, du « soma-signifiant » (David Böhm).
« C’est une folie que de vouloir guérir le corps sans vouloir guérir l’esprit. »
(Platon) (427–348/347 av. J.-C.)
Notre science est un résumé froid et limité
Qui coupe en formule le tout vivant.
Elle a un cerveau et une tête, mais pas d’âme :
Elle voit toutes choses dans un relief taillé de l’extérieur.
Mais comment peut-on connaître
le monde sans ses profondeurs ?
Le visible a ses racines dans le non-vu
Et chaque invisible cache sa signification
Dans un invisible et un non-dévoilé encore plus profond.
Sri Aurobindo (1872–1950)
De la théorie à la pratique – Des prédictions aux faits – Des augures à la réalité
Connaissance spéculative et Connaissance expérimentale
Le difficile art de guérir
Médecine des villes et médecines des campagnes – Médecine d’école et médecines de la vie
(…)
« En médecine, l’expérience est au-dessus de la science. » (Mohammed Ibn Zakaria al-Razi) (Razes) (865–932)
J’ai comme la nette l’impression que plus d’un rationaliste-scientiste est resté prisonnier de sa Caverne, désespérément embastillé dans sa prison cognitive, définitivement captif de son plafond de verre mental, totalement esclave de son flacon invisible !
Gnôthi seautón était-il gravé sur le fronton du temple d’Apollon, à Delphes. Nosce te ipsum. Connais-toi toi-même… et tu connaîtras l’univers et les dieux. Socrate (470 av. J.-C. – 399 av. J.-C.) fera de la maxime sa devise favorite. Héraclite (vers 544–541 av. J.-C. – 480 av. J.-C.) et Mencius (380–289 av. J.-C.) tinrent le même discours.
Oui, au-delà des illusions superstitieuses et des récupérations sectaires, la connaissance de soi conduit à la connaissance de plus grand que soi. C’est ce que nous rappelle également la formule d’Hermès Trismégiste.
« Enfermés dans la cage sombre et exiguë que nous nous sommes fabriquée et que nous prenons pour la totalité de l’univers, rares sont ceux d’entre nous qui peuvent seulement imaginer qu’il existe une autre dimension de la réalité. » (Sogyal Rinpoché)
(…)
Oh ! il ne s’agit pas pour les sages – ni d’ailleurs pour les praticiens des médecines naturelles –, de naïvement gober tout et n’importe quoi, de béatement confondre les vessies et les lanternes, de benoîtement avaler les nombreuses sornettes qui courent de par le vaste le monde, mais en revanche, sans dogme et avec un résolu esprit lucide et critique, d’inlassablement observer, d’assidûment rester ouvert à l’inconnu, à l’extrême complexité de l’univers, aux Vérités transcendantes, à l’immense richesse et diversité des expériences humaines, de continûment les croiser et les tester – fût-ce à sa petite échelle individuelle – sans jamais négliger de les passer au crible de son intelligence, de son intelligence d’esprit et de cœur.
« Le vrai n’est pas toujours vraisemblable. »
(Voltaire) (1694–1778)
Paroles de raison et d’expérience relevées un jour dans un petit atelier familial…
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pas pourquoi.
Parfois théorie et pratique sont réunies : rien ne fonctionne… et personne ne sait pourquoi.
(Attribué à Albert Einstein)
N’est-ce pas le résultat qui compte ? La vérité, c’est ce qui marche !
La preuve par les résultats
Des faits, non pas des théories
Résultat de façade ou résultat de fond ?
Obligation de moyen ou obligation de résultat ?
Les médecines naturelles : médecines à vocation et dimension humaine, médecines du cœur et de l’expérience
Les preuves solides ne s’établissent que sur le (très) long terme
N’est-ce pas avant tout le résultat qui importe, plus que son explication ?
Le développement des savoirs ancestraux ne bénéficiait pas – et de loin -, en proportion, des gigantesques moyens techniques et financiers d’aujourd’hui… Mais, par contre, ces connaissances ont l’immense avantage, elles, de jouir de plusieurs milliers d’années d’expériences humaines, vérifications quotidiennes… empiriques et durables, loin des théories modernes certes, mais ô combien concrètes, bien tangibles.
Et à défaut de pouvoir dans l’immédiat expliquer rationnellement certains phénomènes, contentons-nous donc, dans l’attente de leur éclaircissement, de tirer tous les fruits des expériences acquises et de les maîtriser du mieux possible. Telle semble avoir été de tout temps l’approche réaliste, pragmatique des médecines naturelles.
L’absence de preuve signifierait-elle pour certains la preuve de l’absence ???
Il n’y a pas de meilleur remède que celui qui réussit, affirme un vieux proverbe français.
Tous ceux que la curiosité a poussé une fois au moins dans leur vie, à oser délaisser le confort de leurs pantoufles et quitter les autoroutes du savoir conventionnel, les larges boulevards de la science officielle et des apprentissages balisés, savent qu’il se trouve de par le vaste monde, des réalités, des connaissances, des techniques, des évidences, des énigmes et des mystères que nos Facultés sachantes et autres Institutions académiques omniscientes – qui croient tout connaître – ignorent supérieurement.
Les médecines naturelles, non technicistes, ne cherchent pas tant à être « scientifiques » (surtout au sens de ses détracteurs) qu’à être efficientes, bienfaisantes… ET tout en restant non nocives (non iatrogènes). Car parfois le remède peut s’avérer être pire que le mal… Primum non nocere constituait un des premiers préceptes d’Hippocrate (vers 460–370 av. J.-C.).
Un certain nombre de ceux prêtant – ou plutôt ayant prêté – pourtant sermon sur son prestigieux nom semblent l’avoir un peu vite oublié. Et oublié également que ce grand homme de médecine était tout autant… prêtre… et astrologue…
Vous reprendrez bien un peu de soma n’est-ce pas ? (N.F.)
« Une once de pratique vaut plus qu’une tonne de théorie. »
(Swami Sivananda) (1887–1963)
Causalité & Finalité
Pour quoi ? versus Comment ?
Les médecines naturelles ne cherchent pas tant à expliquer les phénomènes ou à démontrer les arcanes d’un mécanisme qu’à être actives et opérantes pour maintenir ou recouvrer la santé. Elles ont avant tout la préoccupation du résultat final. Elles ont moins le souci du « pourquoi ? » que du « pour quoi ? ». Elles ont la sollicitude de la causalité ET de la finalité. Et non pas l’obsession du moyen, la frénésie du « comment ? ». « Ça marche ! » et c’est bien là l’essentiel.
Le grand physicien Isaac Newton (1643–1727), n’a-t-il pas dit – himself, please… – que « les choses n’ont pas besoin d’être expliquées, il suffit simplement qu’elles soient vraies » ?!
« La rose est sans pourquoi »… écrivait à peu près à la même époque le poète et mystique allemand Angelus Silesius (1624–1677).
Guérir ou Prévenir ?
La médecine institutionnelle ne cherche-t-elle pas davantage à traiter, réduire, les symptômes qu’à rechercher et corriger les causes profondes des déséquilibres qui en sont à l’origine (cf. par exemple l’épineuse – et dramatique – question des cancers et autres nombreuses maladies de civilisation…) ?
(…)
Expressions directes de l’école de la vie, les « sciences traditionnelles » continuent d’avoir encore quelques belles longueurs d’avance sur les scientistes modernes qui ne manquent pas de fâcheusement se borner, de tomber dans de regrettables errements et de se prendre périodiquement les pieds dans d’affligeants péchés de jeunesse.
« Expérience est mère de science. » (Janus Gruter) (1560–1627)
Ainsi, de leurs aveux même, les chercheurs de pointe en physique (pour prendre l’exemple de cette science pourtant dure et faisant appel à des techniques et une instrumentation très sophistiquées) ont-ils maintes fois été surpris – et le sont aujourd’hui encore – d’avoir été devancé dans leurs découvertes inédites par des… philosophes ou des spiritualistes !… et ce de plusieurs millénaires parfois…
Surprenant pour le grand public, non ?
(…)
CE N’EST PAS À LA RÉALITÉ DE SE PLIER À LA THÉORIE, MAIS À LA THÉORIE DE S’ADAPTER À LA RÉALITÉ.
« La raison nous trompe plus souvent que la nature. »
(Marquis de Vauvenargues) (1715–1747)
Savoir – Connaissance – Sagesse
Petit conte tibétain
Pour brève illustration des effets possibles du choc des cultures et des civilisations… Et peut-être bien, à l’occasion, de celui des connaissances, des expériences, des sciences, des idéologies, des prétentions morbides ou du réductionisme maladif…
Les plus perspicaces d’entre les lecteurs/lectrices de ces pages, auront peut-être remarqué que j’affectionne les histoires de grenouille… (Non, rassurez-vous je ne me rêve aucunement en Prince Charmant !)
En voici encore une, emprunté cette fois à Sogyal Rinpoché, dans Le Livre Tibétain de la Vie et de la Mort.
Patrul Rinpoché raconte l’histoire d’une vieille grenouille qui avait passé sa vie entière dans un puits humide et froid.
Un jour, une grenouille qui venait de la mer lui rendit visite :
« D’où viens-tu ? demanda la grenouille du puits.
– Du grand océan, répondit la grenouille de la mer.
– Il est grand comment, ton océan ?
– Il est gigantesque.
– Tu veux dire à peu près le quart de mon puits ?
– Plus grand.
– Plus grand ? Tu veux dire la moitié ?
– Non, encore plus grand.
– Est-il… aussi grand que ce puits ?
– C’est sans comparaison.
– C’est impossible ! Il faut que je voie ça de mes propres yeux ! »
Elles se mirent toutes deux en route. Quand la grenouille du puits vit l’océan, ce fut un tel choc que sa tête éclata.
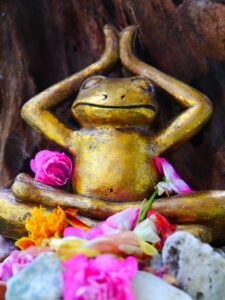
Savoir et Comprendre – L’étroit et difficile chemin de la connaissance
Le savoir isole, cloisonne, détache, met à distance. La connaissance rapproche, englobe, immerge. Doctrine oblige.
Savoirs technicistes versus connaissances primordiales
Sauf rares exceptions, long, très long, est le chemin de la véritable connaissance.
Apprendre et comprendre sont deux notions bien distinctes. On peut tout à la fois être rempli à ras bord de savoirs… et se révéler être complètement vide de sens. Ainsi par exemple, avez-vous peut-être remarqué que si le savoir enorgueillit facilement son dépositaire, la connaissance authentique, bien au contraire, rend foncièrement humble.
La distinction entre savoir (= produit de l’enseignement) et intelligence (= faculté de l’esprit) étant faite, la route est encore longue et semée d’embûches de l’élève au maître.
Et puis, du SAVOIR à la CONNAISSANCE, il y a encore un pas substantiel, une étape conséquente, qui peut égarer et empêcher plus d’un. Car les obstacles et les chausse-trapes sur le sentier de la connaissance sont nombreux (aveuglement, présupposés, idéologie, exaltation, démotivation, peur, paresse intellectuelle, etc… pour n’en citer que quelques-uns).
Je doute, donc je suis, me paraît être un salutaire garde-fou à la suffisance et à l’intolérance.
Quand un homme ordinaire atteint le savoir, il est sage. Quand un sage atteint la compréhension, il est un homme ordinaire, nous apprend un koan zen.
« Trop occupés à apprendre ce qu’ils ne savent pas, les hommes oublient ce qu’ils connaissent des lois de la nature. » (Tchouang-tseu) (IVe siècle avant J.-C.)
(…)
Plus on sait, moins on sait, expérimente le sage.
Le savoir se situe majoritairement encore dans l’avoir. Le savoir éclaire le chemin du scientifique. La conscience – est la lumière qui – éclaire celui du sage. La connaissance est l’octave supérieure du savoir. Elle est un savoir conscientisé, imprégné, positivement polarisé et irradié de conscience. Elle est de l’ordre, de l’essence de l’être. Ce n’est pas tant le savoir qui rend intelligent, que la conscience qui ouvre la connaissance, que le discernement qui conduit à la sagesse. Dans « connaissance », il y a aussi « naissance » et « sens ». Là où la plupart d’entre nous ne voient que l’obscurité, il en est d’aucuns qui voient la claire lumière.
« N’est-ce pas savoir beaucoup que de savoir qu’on ne sait rien ? » (Fénelon) (1651–1715)
« Le savoir est un produit [de l’enseignement] mais l’esprit est vie. » Conscience et connaissance engendrent un supplément d’être, génèrent un supplément de vie.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance.
(…)
« La science a fait de l’homme des dieux avant de faire de nous des hommes. »
(Jean Rostand) (1894–1977)
Enfin… à quoi même rime la connaissance si elle n’amène pas à la sagesse ? À quoi bon la connaissance si celle-ci ne nous rend pas meilleur, plus tolérant, plus ouvert, plus conscient, plus respectueux… ? Cette connaissance devrait pourtant nous amener sur les pas de ses parents éternels que sont la SAGESSE et l’AMOUR.
… Et la conscience, la sagesse, l’amour, conduisent tout naturellement à la… RE-CONNAISSANCE !… À la GRATITUDE.
Combien d’entre nous sont encore reconnaissants ?
« La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute. » (Pierre Desproges) (1939–1988)
Entre science et conscience…
Du machiavélisme et du mauvais génie dans l’homme
La science donne-t-elle la sagesse ??
De la science à la conscience, il y a comme un petit pas… voire parfois un gouffre…
Se pose ici une question indiscrète, inconvenante, voire même indécente. La science moderne, au travers notamment de ses – soi-disant – réussites(*1) nous mène-t-elle sur le chemin vertueux et serein de la sagesse ou bien sur les sulfureux et chaotiques boulevards de l’illusion, sur les avenues faciles des apprentis-sorciers(*2), au mieux sans issue ou alors au pire, nous conduisant tout droit au précipice ?
À ce propos, l’assertion – se faisant au fil des ans plus précise et incantatoire – selon laquelle la toute puissante Technoscience sauvera l’humanité de son propre désastre ne pourrait-elle pas, elle aussi, n’être qu’une pensée magique ?! Une de plus produite par ce système cupide, cynique et aveugle… Et, hélas ! peut-être même une allégation mensongère ! Une de plus aussi…
(*1) Cf. par ex. le tout-chimique (chimie de synthèse systématique dans tous les domaines), le tout-sans-fil (et le dense brouillard électromagnétique en résultant), le déploiement à grande échelle du nucléaire (civil et militaire), des OGM et PGM, des nano-technologies, des biotechnologies, de la fracturation hydraulique, de l’exploitation des gaz de schistes, le pillage en règle des savoirs ancestraux, des pharmacopées des tradipraticiens, le brevetage – éhonté – du vivant (dont le génome humain), etc., etc… Et ce ne sont pas les derniers développements de la biologie de synthèse qui vont nous rassurer.
Et puis n’oublions pas que Hiroshima, Nagasaki, le Vietnam (agent orange), Seveso, Bhopal, Tchernobyl, Fukushima, etc… tout comme le changement climatique actuel et tant d’autres monstrueux – et souvent silencieux – écocides sont hélas eux également les fruits – en l’occurrence toxiques, mortifères – de la Science et de l’hybris des hommes.
(*2) : Sur ce sujet, cf., par exemple, les appels pressants à la responsabilité des scientifiques par le physicien polonais Józef Rotblat (1908–2005) – le seul scientifique à avoir quitté le projet Manhattan avant la destruction d’Hiroshima en août 1945 –, prix Nobel de la paix (1995).
Cf. aussi les dénonciations acerbes du technoscientisme par le mathématicien de renommée mondiale (médaille Fields en 1966) et aussi pionnier de l’écologie, écrivain, mystique… Alexandre Grothendieck (1928–2014) – entre autres – tout comme son engagement, sa cohérence personnelle et professionnelle face à cette question essentielle de la responsabilité des scientifiques eu égard à leurs travaux et à leurs récurrentes collaborations notamment avec l’institution militaire ou avec les chantres de l’énergie nucléaire.
« Science for a better live » nous promet doucereusement, dans une de ses publicités, un chimiste chimiquant planétairement. Puissiez-vous bien l’entendre.
Alfred Nobel (1833–1896), le célèbre inventeur de la dynamite, avait déjà en son temps – plus précisément dans son testament, il est vrai… – ouvertement dénoncé et déploré l’alliance entre la science et la guerre. Il en savait quelque chose. Il était aussi fabricant d’armes.
« Les scientifiques ont la responsabilité de s’assurer que leurs découvertes sont utilisées pour le bien de l’humanité et non
pour sa destruction. » (Joseph Rotblat) (1908–2005)
« Au début, nous pensions qu’avec des connaissances scientifiques, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde,
on arriverait à mieux appréhender une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion.
Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d’un supplément de connaissances scientifiques, d’un supplément de techniques, mais qu’elle proviendra d’un changement de civilisation. » (Alexandre Grothendieck) (1928–2014)
Tout est dit.
À observer certains comportements, il semblerait bien qu’un esprit savant ou un savoir encyclopédique ne soit pas foncièrement incompatible avec la conscience d’un moineau, d’une huître, d’un pois chiche, ou d’un caillou – sans vouloir offenser ni les oiseaux, ni les papilionacées ou les lamellibranches, ni les pierres, qui ont peut-être plus de conscience que l’on puisse imaginer de prime abord.
« Se peut-il qu’un homme soit moins sage qu’un oiseau », se demandait déjà Confucius, cinq siècles avant notre ère.
Le savoir peut se copier, se dupliquer, se communiquer, s’échanger, se distribuer, se monnayer… Mais pas la sagesse, par contre. Sagesse qui, soit dit en passant, ne s’enseigne et ne s’apprend pas tout à fait comme l’algèbre, par exemple… Philosophie, sage, vertueuse sagesse qui fait si peu – en vérité, de moins en moins, voire plus du tout – partie des programmes d’enseignement scolaire et des cursus de formation… Perte de temps ? Superflue ? Inutile ? Dépassée – surtout à l’heure de l’IA ? Rétrograde ? Trop encombrante ? Trop gênante ? Trop corrosive ?…
Idem des cours d’Histoire…
Le transhumanisme passe par là. Tout ce qui construit l’humain est expurgé. Tabula rasa du passé !
Place à la technoscience ! Place au post-humanisme !
Vive moi ! Vive la technologie !… [et le nouvel esclavage !]
Exit la sapience ! Place à l’efficience !
CQFD.
Finalement, sommes-nous sur terre pour seulement (s)avoir, ou bien, surtout, pour réfléchir, comprendre, être ?
« On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même […] car elle est un point de vue sur les choses. » (Marcel Proust) (1871–1922)
« La liberté intellectuelle, ou Sagesse, c’est le doute. » (Alain) (1868–1951)
« Un enseignement de la science qui n’apprend pas à penser n’est pas un enseignement de la science, il est un enseignement de la soumission. » (Évry Schatzman) (1920–2010)
(…)
« Si nous attribuons les phénomènes inexpliqués au hasard, ce n’est que par des lacunes de notre connaissance. »
(Pierre Simon Laplace) (1749–1827)
De la soutane à la blouse – Fâcheux glissement de compétence
Lorsque la blouse blanche – et non la « soutane » ou la robe – traite les maux de l’âme.
Dommageable refoulé du religieux
Lorsque le péché devient maladie
Il s’est produit au cours du XXe siècle, avec la laïcisation de la société et pour bien d’autres raisons, un profond et irréversible glissement du religieux vers la médecine – et accessoirement la science – entraînant de graves méprises, d’énormes contre-sens – et non-sens –, lourds de conséquences. Dans la société d’aujourd’hui, le médecin a, y compris spécifiquement pour les maladies de l’être et du sens de l’existence, irrévocablement remplacé le prêtre. Et ni l’un, ni l’autre ne peuvent se retrouver dans ce cruel quiproquo… Et moins encore leurs consultants.
Voici quelques-unes de ces transpositions (cf. Karl Marx, René Guénon, Olivier Clerc…) :
- Le sacré → le profane
- La religion → la science
- Le religieux → le médical
- Le prêtre → le médecin
- La soutane → la blouse blanche
- Le salut → la santé
- Le mal, le péché → la maladie
- La confession → l’anamnèse
- La communion → célébrations diverses (découvertes médicales, victoires thérapeutiques, etc.)
- L’église (le temple) → l’hôpital
- La cathédrale → le CHU/CHR
- La Providence → la foi dans la Technologie
- L’hostie → le médicament (pilule, gélule, comprimé…)
- La quête → les machinthons, trucactions, fondationuntel…
- Les fidèles → les patients
- La vie éternelle → l’immortalité physique
- Le baptême, le rite initiatique → la vaccination
- Etc.
« Nous n’avons pas perdu la foi, mais au lieu de la placer en Dieu nous l’avons transférée à la profession médicale. »
(George Bernard Shaw) (1856–1950)
Personnellement, je rajusterai légèrement ce constat, en soutenant que notre foi en Dieu nous l’avons complètement et aveuglément reporté en la science matérialiste et en la technologie.
Un petit exemple repris de mes précédents écrits
De l’art à… l’empathie
Lorsqu’il est – enfin – reconnu que l’art soigne… même les soignants
L’Art au service de l’art… de soigner
À la suite de découvertes récentes, pour développer un peu plus le sens de l’empathie de leurs étudiants, les principales facultés de médecine américaines viennent-elles tout juste de mettre en place un ambitieux programme d’initiation des futurs soignants à… l’art ! Seraient-elles – enfin – en train de comprendre que la médecine est autant art et philosophie que science et technique ?
Rien là de surprenant car les arts – dont la musique –, c’est bien connu, entre autres, adoucissent les mœurs. Revirement intéressant à noter, après leur sensibilisation à la psychologie…
Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Toutefois il en est qui, indéniablement, semble avoir séché au moins tous les cours de tolérance et d’humilité. Faudra-t-il proposer à ces derniers des cours de rattrapage ?
Bienvenu dans le monde des Arts ! Espérons aussi que, par la même occasion, l’art-thérapie(*) – utilisée depuis très longtemps par les praticiens non conventionnels – va pouvoir enfin se sentir un peu plus reconnue et soutenue par ces nouveaux venus de la Science…
(*) : Objet de risée et qualifiée jusque-là de “foutaise” et de “charlatanisme” par le savant Corpus scientificus…
« Les perceptions créent la réalité. Changer vos perceptions changera votre réalité. »
(Deepak Chopra)
En conclusion
Contrairement à ce qu’affirment un certain nombre de scientistes, le pouvoir de la pensée rationnelle n’est pas sans limites. En effet, en vertu du par exemple seul « théorème d’incomplétude » (Gödel, 1931) il existe toujours une limite à notre connaissance d’un système donné… pour la bonne et simple raison que nous faisons nous-mêmes intégralement partie de ce système…
Sans même invoquer l’implication et la portée de la « décohérence » formulée par la physique quantique, ou du « principe d’incertitude (ou théorème d’indétermination) » [imprédictibilité radicale dans l’univers] énoncé en 1927 par Heisenberg… et tout en laissant à son bon sort – indéterminé, évidemment ! – l’illustre – et tout virtuel – chat de [Monsieur] Schrödinger… dans son joli nuage… de probabilité.
« L’homme se trompe plus souvent, plus longtemps, plus dangereusement, quand il fait des raisonnements justes à partir de points de départ faux que lorsqu’il fait des raisonnements faux à partir d’idées directrices justes. » (Blaise Pascal) (1623–1662)
N’oublions jamais que nous savons si peu en regard de ce que nous ignorons. Restons donc modestes, tous les savoirs humains cumulés ne représentent qu’une infime goutte d’eau dans un abîme d’ignorance. Même pensant, l’homme demeure un roseau. Relativisons les choses et gardons à l’esprit que les croyances – et même les cultes – sont loin d’être le monopole – ou du seul registre – des religions ou des superstitions comme d’aucuns s’échinent – à grands moyens et frais – à nous le faire croire.
Puissent ces précieux aphorismes – égrainés à dessein tout au long de ces pages – résonner à votre conscience et éclairer votre vie.
« Apprendre est l’essence de la vie. »
(Krishnamurti) (1895–1986)
–oOo–
Cf. aussi les autres pages Con-Science et les pages Santé globale, Plaidoyer pour la liberté thérapeutique et la diversité des médecines.
– Toute reproduction, même partielle, strictement interdite –